ça va finalement, j'avais peur que mon niveau d'anglais soit trop faible.
[Lecture] Bouquins à se mettre sous la dent
Je me suis lancée à relire le trone de fer mais cette fois en vo pour être prête pour la sortie du nouveau en Juillet 
ça va finalement, j'avais peur que mon niveau d'anglais soit trop faible.
ça va finalement, j'avais peur que mon niveau d'anglais soit trop faible.
- Bouh
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1295
- Inscription : 27 oct. 2010 14:00
- Localisation : région Parisienne
Et moi, il faut que je me motive pour le lire tout court !!Shyria a écrit :Je me suis lancée à relire le trone de fer mais cette fois en vo pour être prête pour la sortie du nouveau en Juillet
ça va finalement, j'avais peur que mon niveau d'anglais soit trop faible.
baladeurs: cowon j3 - Hisoundaudio Rocoo BA
casque:audio technica ath m50
intras:1964-Q, mee audio m6, fiio fh1, fiio f9 pro
" "Tandis que l'oreille du sage sait déceler l'élixir, L'oreille du singe ne recèle que de la cire!!"...ça veut dire que t'entends que dalle!!"
De JBX dans Reflet D'Acide
casque:
intras:
" "Tandis que l'oreille du sage sait déceler l'élixir, L'oreille du singe ne recèle que de la cire!!"...ça veut dire que t'entends que dalle!!"
De JBX dans Reflet D'Acide
- Denis Gaudineau
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1202
- Inscription : 24 nov. 2010 16:29
Manchette - Tardi : La position du tireur couché (2010), plutôt agréable dans l'ensemble, le rythme est alerte et ça canarde de partout.Un bémol sur la fin un peu vaseuse (je ne peux pas comparer cette BD avec le polar d'origine, ne l'ayant pas lu) 
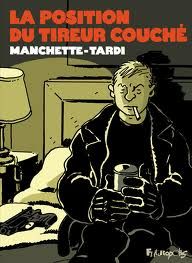

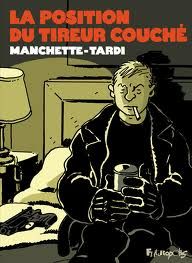
Donner, c'est donner, repeindre ses volets.
- apow
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1231
- Inscription : 25 oct. 2010 21:10
- Localisation : Montréal
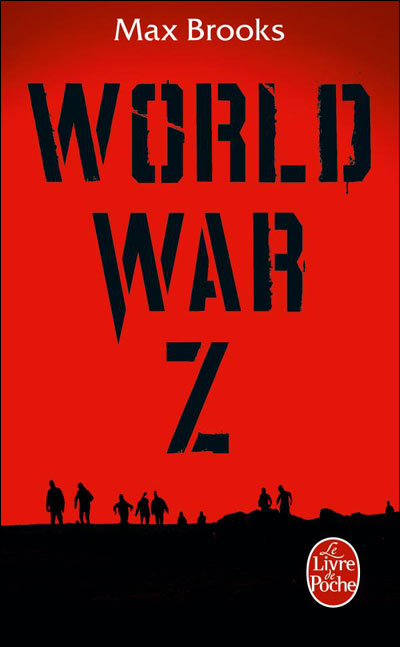
Baladeurs DAC actuels : Sony nw-zx507 + iBasso DC06 Pro
Anciens Baladeurs: iPod Classic 120, Sansa Clip Zip et iPhone 4s, Creative Zen Vision M, Ipod Photo, iPod Vidéo 30Gb, Archos 5 60Gb, iPod Nano 1Gen & 2Gen, Archos jbmm, Sony NW A3000...
Casque/intra actuels: Final Audio E5000, Casque Sennheiser Mommentum 4, Devialet Gemini
Anciens casque/intra: Monster Turbine Pro Gold, Brainwavz M2 et AKG K450, Grado SR60i, SoundMagic Pl30 & Pl 50, Brainwavz Alpha, Koss SparkPlug, SoundMagic P20, Koss Porta Pro...
Anciens Baladeurs: iPod Classic 120, Sansa Clip Zip et iPhone 4s, Creative Zen Vision M, Ipod Photo, iPod Vidéo 30Gb, Archos 5 60Gb, iPod Nano 1Gen & 2Gen, Archos jbmm, Sony NW A3000...
Casque/intra actuels: Final Audio E5000, Casque Sennheiser Mommentum 4, Devialet Gemini
Anciens casque/intra: Monster Turbine Pro Gold, Brainwavz M2 et AKG K450, Grado SR60i, SoundMagic Pl30 & Pl 50, Brainwavz Alpha, Koss SparkPlug, SoundMagic P20, Koss Porta Pro...
- Denis Gaudineau
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1202
- Inscription : 24 nov. 2010 16:29

Ça fait un mois que j'essaie de lire ce qui est considéré comme le chef-d'oeuvre de Sterne : La Vie et les opinions de Tristram Shandy. Le fond avait l'air truculent mais l'histoire est très compliquée à suivre (un accouchement a lieu au départ et 200 pages plus loin, il n'est toujours pas achevé), comme un film devant lequel on passerait son temps à s'endormir et à se réveiller, ça digresse à tout bout de champ mais une chose m'a mis la puce à l'oreille, c'est que l'annotateur du texte, dans cette édition de poche de 1982, passe son temps à corriger à la fin du bouquin, via les notes, la traduction de 1946 qui est présentée
 . Résultat, ça devient souvent pénible à suivre, comme ces traductions de monologues de Benny Hill, absolument pas drôles parce que mal traduites au possible
. Résultat, ça devient souvent pénible à suivre, comme ces traductions de monologues de Benny Hill, absolument pas drôles parce que mal traduites au possible 



http://www.lekti-ecriture.com/contrefeu ... handy.html


Sylvie Martigny & Jean-Hubert Gailliot a écrit :
Qui a peur de Tristram Shandy ?
Publié le mardi 10 octobre 2006
L’Université française transmet-elle dans les meilleures conditions enthousiasme et connaissance des grands chefs-d’œuvre de la littérature universelle à ses étudiants en lettres ?
Pour ce qui est de La Vie et les opinions de Tristram Shandy de Laurence Sterne, classique anglais du XVIIIe siècle, l’un de ces rares livres, aux côtés de ceux de Cervantès ou de Rabelais, dont on peut dire qu’ils ont changé le cours de l’histoire littéraire, mis au programme de l’agrégation de Lettres Modernes cette année, rien n’est moins sûr.
Rappelons de quel monument il s’agit pour s’étonner qu’il soit resté si peu visible dans la culture française jusqu’à une date récente.
De Salman Rushdie à Milan Kundera, d’Italo Calvino à Jonathan Coe, tout le monde est d’accord : Tristram Shandy est un roman où l’imagination narrative et verbale est sans précédent, une œuvre qui joue de tous les registres du comique pour faire de l’esprit de sérieux sa cible privilégiée. Plus important encore, c’est le livre de la démolition de tous les discours académiques et de toutes les autorités - et en cela l’un des plus libérateurs jamais écrits.
Son influence, aveuglante chez Diderot, écrasante chez Joyce, évidente chez Kerouac, plus que jamais présente dans ce qui s’écrit aujourd’hui de plus neuf, déborde même désormais le strict domaine de la littérature. Comme il est dit dans le film de Michael Winterbottom récemment adapté de Tristram Shandy : « Un classique postmoderne à une époque où le modernisme n’était même pas encore né ! »
Las, pendant des décennies, notre Université s’est ingéniée à dégoûter des générations d’étudiants de Sterne et de Tristram Shandy.
À preuve, l’entreprise de découragement fonctionna si bien, qu’en 1990, en France, Tristram Shandy avait à peu près disparu des esprits et purement et simplement des librairies. Plus aucune édition disponible pendant des années, et personne, dans les rangs de l’Université ou ailleurs, pour s’en offusquer.
Comment avait-on pu en arriver là ?
C’est que depuis 1946 on nous avait infligé la traduction du professeur Charles Mauron, le pensum le plus appauvrissant et anti-shandéen qui se puisse concevoir. Dépouillant le texte de Sterne de ses attributs les plus remarquables, cette vieille traduction réussit en effet le tour de force d’en donner une version ennuyeuse, fautive et incomplète, de nature à faire fuir tout lecteur innocent.
Telle était la triste situation lorsque, à la fin des années 80, créant une maison d’édition à l’enseigne de Tristram, nous avons rencontré Guy Jouvet, engagé depuis longtemps, en solitaire, dans la traduction de Sterne. Sans demander d’autorisation à personne, nous décidons alors ensemble de proposer une édition qui renoue point par point avec l’esprit et la lettre de l’auteur.
En 1998, paraît la traduction en un tome des deux premiers « volumes » du roman (qui en compte neuf), abondamment annotés et commentés par Guy Jouvet lui-même. L’enthousiasme de la critique est immédiat. Le premier tirage s’épuise en quelques mois. Les lecteurs français, qui découvrent ou redécouvrent Tristram Shandy dans cette version joyeusement érudite, réclament la suite.
Tandis que le perfectionniste Jouvet approfondit son énorme travail d’exégèse pour les trois tomes suivants de l’édition critique, nous publions enfin, en 2004, sa traduction intégrale du roman. L’ouvrage, loué de toutes parts, devient, dans la catégorie qui est la sienne, celle des classiques, un succès de librairie. Tristram Shandy, comme cela n’aurait jamais dû cesser d’être le cas, est à nouveau partout. On lui consacre des essais, des dossiers de revues. Les écrivains recommencent à le citer comme une source d’inspiration majeure et un modèle.
L’Université, alertée par cette renaissance dans laquelle elle n’a joué aucun rôle, se réveille à son tour et prend une heureuse décision : inscrire Tristram Shandy au programme de l’agrégation de Lettres Modernes. Sujet de littérature comparée : « Naissance du roman moderne - Rabelais, Cervantès, Sterne ».
Mais le croira-t-on ? Quand l’Université se réveille, c’est encore à l’heure de 1946 ! Guy Jouvet a redonné vie à Tristram Shandy ? L’Université redonnera vie au professeur Mauron ! Et c’est ainsi que, soixante ans plus tard, on exhume officiellement la traduction de sinistre mémoire, pour la remettre, d’autorité, entre les mains d’une nouvelle génération d’agrégatifs ! Pauvres étudiants français !
Mesurons rapidement l’étendue des dégats.
Alors que Sterne fait preuve d’un usage révolutionnaire de la typographie et de la ponctuation, d’une science rythmique et sémantique si extraordinaire qu’elle est l’instrument même de sa pensée et de sa sidérante vélocité : la version Mauron fait l’impasse, découpe en paragraphes, en particulier les dialogues, brise le flux du texte et toutes ses merveilles rythmiques, supprime les tirets, les fameux tirets de Sterne, comme si on supprimait les trois points de Céline !
Mais il y a aussi les spectaculaires bévues du professeur. Un seul exemple. Au Volume III, chapitre XXXVI, on peut lire dans la traduction de Guy Jouvet : « - Hé ! je vous prie, qui était la jument de Tapequeue [“Tickletoby” chez Sterne, que Charles Mauron ne traduit pas et laisse tel quel] ? - Ah ! c’est bien là le genre de question aussi déshonorante, Monsieur, et qui trahit autant l’ignorance crasse de son auteur, que si vous demandiez en quelle année a éclaté la seconde guerre punique ! - Qui était la jument de Tapequeue ! - Mais lisez, lisez, lisez, lisez donc ! » Ce n’est pas dans la version Mauron que l’étudiant français reconnaîtra la jument et le texte de Rabelais précédemment pastiché, où se trouve pourtant la traduction de « Tickletoby » : Tappecoue [Tapequeue] (Quart Livre, 13). Car le professeur Mauron fait aussi fi de l’arsenal onomastique mis au point par Sterne, qui attribue une signification aux noms propres, chacun donnant l’image distinctive d’un être, la représentation de son caractère, la définition et la métaphore de son univers. Sterne traduit Tapequeue en Tickletoby, mais le professeur Mauron ne traduit pas Tickletoby, ni Docteur Slop (boue, immondice, crotte) ni aucun des patronymes hauts en signification et ressorts comiques des personnages du roman.
Ce n’est pas ici le lieu de répertorier les contresens qui fourmillent dans la version Mauron (une mouche « d’une grosseur phénoménale » [overgrown], qualifiée par le professeur de « dégingandée » !) ou les choix désolants de certains termes (« chimère » au lieu de « dada » ou « califourchon », pour « hobby-horse », l’un des terme-clefs du livre) : ils sont légion et ce n’est qu’une revue de détail - à l’Université ? - qui pourrait en rendre compte.
Au-delà d’une vision aplatissante de ce qui fait la singularité de Tristram Shandy, des bourdes et approximations incessantes, le plus fâcheux reste que dans cette version tragiquement dénuée d’esprit, de style et de légèreté, ce sont la saveur et la sève mêmes du texte de Sterne qui disparaissent. Cette vigueur sans pareille que Guy Jouvet a justement su recréer en français, avec une énergie dévastatrice, à chaque ligne de sa nouvelle traduction. Alors nous posons la question : qui a peur de Tristram Shandy ?
Donner, c'est donner, repeindre ses volets.
- cpt_caverne
- Il est frais mon topic !

- Messages : 10159
- Inscription : 02 déc. 2010 13:09
- Localisation : Lyon
- Contact :
J' veisn de commencer ça je verrais si ça me plait il y a 4Tomes.
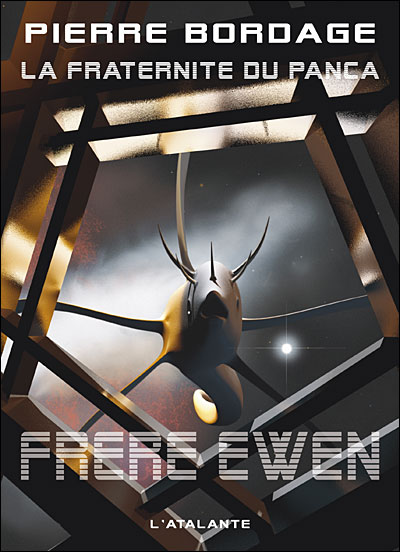
& apres j'ai repéré ça aussi
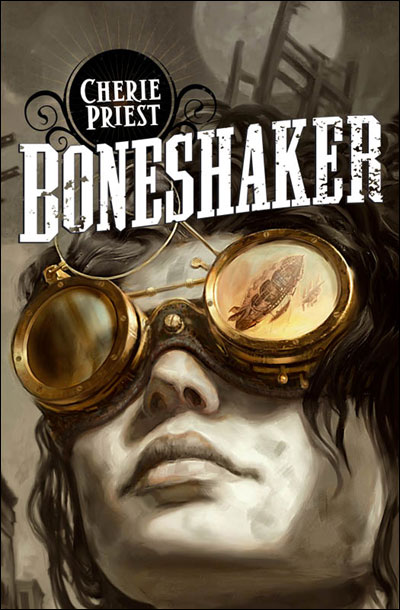
Purée va falloir que j'arrète les apérots pour lire tout ça
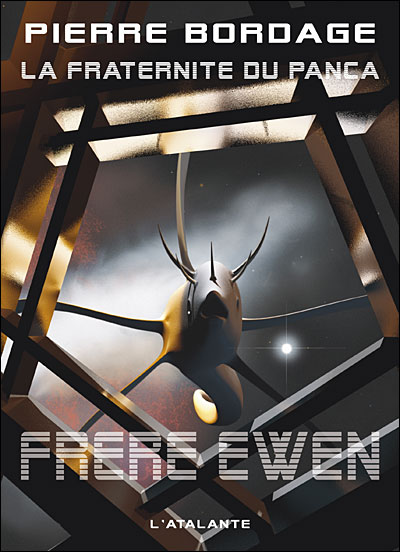
& apres j'ai repéré ça aussi
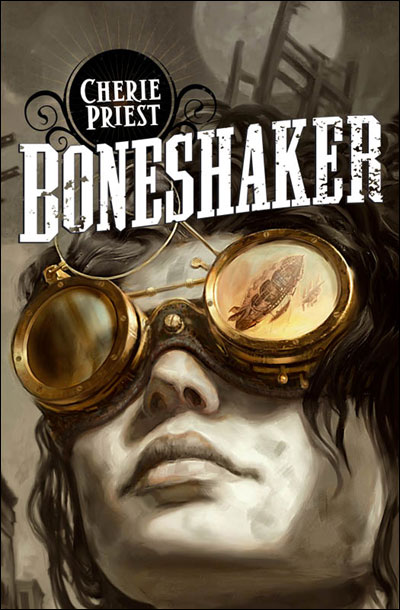
Purée va falloir que j'arrète les apérots pour lire tout ça
Retraité des cages à miel... 
-Nomade: Fioo Q15 Ti, Focal Celestee ou Tanchjim Space, dunu 3001
-Sédentaire: Fiio Q15 + Focal Celestee.., AKG K601 Recablé , AKG K340
-Wanted => SIG Pro... Celestee... Ouff
-Rip: Onkyo E900M, E2000, ColorFly C4 Pro, Samsung YP-R0 Rb, Letv All-metal, O2, EPH-100, Mad Dog 3.2, HD381, Brainwavz M2, HisoundAudio AMP3 M, Sansa clip +, Ampli Fiio E11, Cowon X5l, Zen mozaic, K518Dj, PL30, Sony EX71, Panasonic HJE50, EPS 630...
-Nomade: Fioo Q15 Ti, Focal Celestee ou Tanchjim Space, dunu 3001
-Sédentaire: Fiio Q15 + Focal Celestee.., AKG K601 Recablé , AKG K340
-Wanted => SIG Pro... Celestee... Ouff
- apow
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1231
- Inscription : 25 oct. 2010 21:10
- Localisation : Montréal
L'apéro tue le Livre. 
(J'en suis à la moitié de World war Z, il est vraiment très prenant)
(J'en suis à la moitié de World war Z, il est vraiment très prenant)
Baladeurs DAC actuels : Sony nw-zx507 + iBasso DC06 Pro
Anciens Baladeurs: iPod Classic 120, Sansa Clip Zip et iPhone 4s, Creative Zen Vision M, Ipod Photo, iPod Vidéo 30Gb, Archos 5 60Gb, iPod Nano 1Gen & 2Gen, Archos jbmm, Sony NW A3000...
Casque/intra actuels: Final Audio E5000, Casque Sennheiser Mommentum 4, Devialet Gemini
Anciens casque/intra: Monster Turbine Pro Gold, Brainwavz M2 et AKG K450, Grado SR60i, SoundMagic Pl30 & Pl 50, Brainwavz Alpha, Koss SparkPlug, SoundMagic P20, Koss Porta Pro...
Anciens Baladeurs: iPod Classic 120, Sansa Clip Zip et iPhone 4s, Creative Zen Vision M, Ipod Photo, iPod Vidéo 30Gb, Archos 5 60Gb, iPod Nano 1Gen & 2Gen, Archos jbmm, Sony NW A3000...
Casque/intra actuels: Final Audio E5000, Casque Sennheiser Mommentum 4, Devialet Gemini
Anciens casque/intra: Monster Turbine Pro Gold, Brainwavz M2 et AKG K450, Grado SR60i, SoundMagic Pl30 & Pl 50, Brainwavz Alpha, Koss SparkPlug, SoundMagic P20, Koss Porta Pro...
Moi je reste dans du classique avec les "paradis artificiels" de beaudelaire.
- Bouh
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1295
- Inscription : 27 oct. 2010 14:00
- Localisation : région Parisienne
Bouquin à lire pour le lycée

Je m'attend au pire...

Je m'attend au pire...
baladeurs: cowon j3 - Hisoundaudio Rocoo BA
casque:audio technica ath m50
intras:1964-Q, mee audio m6, fiio fh1, fiio f9 pro
" "Tandis que l'oreille du sage sait déceler l'élixir, L'oreille du singe ne recèle que de la cire!!"...ça veut dire que t'entends que dalle!!"
De JBX dans Reflet D'Acide
casque:
intras:
" "Tandis que l'oreille du sage sait déceler l'élixir, L'oreille du singe ne recèle que de la cire!!"...ça veut dire que t'entends que dalle!!"
De JBX dans Reflet D'Acide
-
cedric7693
- Le fil rouge dans la prise rouge !

- Messages : 53
- Inscription : 14 mars 2011 10:21
- Localisation : Neuilly Plaisance
- Contact :
Pour ma part, deux auteurs qui m'ont "giflé" : Paul Auster (jusqu'au Livre des illusions, après je n’accroche plus tellement car je trouve qu'il se répète) et James Ellroy (Sauf l'avant dernier Underworld USA et le dernier que je ne l'ai pas lu mais il a plutôt mauvaise presse).
Ma dernière sensation c'est D.O.A http://www.markusfreys.com/
Ma dernière sensation c'est D.O.A http://www.markusfreys.com/
Baladeur : Cowon J3
Casques : Koss Portapro + SB45 + KSC75 monté sur arceau Portapro - MEelectronics HT-21 - Jays a jays one
Casques : Koss Portapro + SB45 + KSC75 monté sur arceau Portapro - MEelectronics HT-21 - Jays a jays one
- Denis Gaudineau
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1202
- Inscription : 24 nov. 2010 16:29
- Didier Eberoni : Samouraï (2010), une BD qui se passe à Paris en 2080 avec un trait à la Bilal pas déplaisant. Le monde est devenu ultra-surveillé, ultra-consommateur et le porno y est roi. Pourquoi pas mais le hic est que l'histoire est malheureusement inconsistante et souvent assez poético-vaseuse, on reste fortement sur notre faim... 

- Jirô Taniguchi & Hiroki Kawakami : Les années douces (t.2) (2008), la suite du premier tome, toujours bourrée de sensualité et de frôlements de tabou, une histoire alcoolisée vraiment réussie de bout en bout mais à réserver aux adultes !

- Urasawa : Happy (tome I), (1993) l'histoire d'une jeune fille soutien de famille qui doit devenir championne de tennis sous peine d'aller gagner sa vie au lupanar. C'est sans véritable surprise mais toujours aussi bien dessiné et avec un dynamisme constant qui rend la lecture très agréable, ça se lit d'une traite



- Jirô Taniguchi & Hiroki Kawakami : Les années douces (t.2) (2008), la suite du premier tome, toujours bourrée de sensualité et de frôlements de tabou, une histoire alcoolisée vraiment réussie de bout en bout mais à réserver aux adultes !


- Urasawa : Happy (tome I), (1993) l'histoire d'une jeune fille soutien de famille qui doit devenir championne de tennis sous peine d'aller gagner sa vie au lupanar. C'est sans véritable surprise mais toujours aussi bien dessiné et avec un dynamisme constant qui rend la lecture très agréable, ça se lit d'une traite

Donner, c'est donner, repeindre ses volets.
- Denis Gaudineau
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1202
- Inscription : 24 nov. 2010 16:29
Osamu Tezuka : Prince Norman (t. III) (1968), la fin de ce bon manga d'aventure qui narre l'aventure de la Lune et de ses habitants 

 , Germinal, Pot-Bouille, par exemple)
, Germinal, Pot-Bouille, par exemple)


C'est sûr, c'est pas joyeux, par contre c'est un des meilleurs Zola et je te conseille de ne pas le lire sous forme d'extraits. Tous les Zola ne sont pas bons (Le Rêve et Madelaine Férat sont pénibles voire mal écrits) mais certains sont vraiment géniaux (La Terrebouh a écrit :Bouquin à lire pour le lycée
Je m'attend au pire...
Donner, c'est donner, repeindre ses volets.
- barz13
- Tombeau-Blaster

- Messages : 4542
- Inscription : 21 nov. 2010 21:51
- Localisation : Face à la meeeer
Tezuka est l' homme qui a révolutionné le manga ! Il faudrait que je me choppe la réedition de son manga "Le Roi Leo" (et tout ce qu' il a écrit aussi d' ailleur) qui a trés trés fortement inspiré Le Roi Lion des studios walt disney.
Baladeur : Cube C30, Cowon Plenue D + 32Go, Sansa Clip Zip 8Go + 32Go
Intra : Audio Technica ATH IM-70, Braniwavz Pro Alpha
Fervent auditeur des aboiements de DMX en HD.
Intra : Audio Technica ATH IM-70, Braniwavz Pro Alpha
Fervent auditeur des aboiements de DMX en HD.
La zone du dehors, de la SF sympathique qui se lit plutôt très bien. Assez bien ficelé, dans l'esprit de 1984 de orson wells mais remis au jour, et avec un point de vue assez différent, le livre se permet en prime de faire l'éloge de l'anarchisme mais pas que.
- Denis Gaudineau
- Je mange des Kellogg's Corn Flac

- Messages : 1202
- Inscription : 24 nov. 2010 16:29
- Rick Remender & Greg Tocchini : The last days of American crime (2009), j'attends de voir la suite de ce premier volume d'un comics au dessin dur, des traits au couteau et une intrigue elle aussi dure mais pas assez développée pour un premier tome... 

- Igort : Les Cahiers ukrainiens (2010), une évocation italienne de la grande famine et de la dékoulakisation de 1931-1932 qu'organisèrent Staline et ses sbires. C'est glaçant et très bien dépeint.





- Igort : Les Cahiers ukrainiens (2010), une évocation italienne de la grande famine et de la dékoulakisation de 1931-1932 qu'organisèrent Staline et ses sbires. C'est glaçant et très bien dépeint.




Donner, c'est donner, repeindre ses volets.


